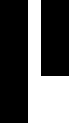Par Aurélien Rousseau, député Place publique, ancien ministre de la Santé
L’Assemblée nationale examine une loi rare dans la vie démocratique d’un pays. Une loi qui se lie à l’intime, dépasse les clivages politiques et interroge notre modèle de société : la fin de vie. C’est sans doute le débat le plus décisif de cette législature.
Ce texte, j’ai contribué à l’élaborer. Comme ministre de la Santé, j’ai participé aux concertations, aux arbitrages, aux rédactions successives. J’en connais la complexité, j’en mesure la portée et la gravité. Comme parlementaire aujourd’hui et citoyen, je suis convaincu qu’il est temps. Ce texte est nécessaire.
J’ai entendu et lu de nombreux témoignages poignants, bouleversants. J’ai aussi entendu les craintes, tout aussi légitimes. Et je veux le redire avec force : il ne s’agit pas d’ouvrir un droit sans limite ni encadrement. Il s’agit d’un droit strictement défini, réservé à des situations exceptionnelles. Un droit à demander une aide à mourir, possible uniquement lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies : lorsque la volonté est libre, éclairée et réitérée, lorsque la maladie est incurable, lorsque la souffrance est insupportable.
Simone Veil disait : « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement ». Il en va de même pour l’aide à mourir : nul ne la demande à la légère. C’est pourquoi cette loi ne pourra être mise en œuvre sans un effort massif et urgent pour développer les soins palliatifs. Cela doit être une priorité nationale. Car il serait inacceptable que certaines personnes aient recours à cette aide uniquement parce qu’elles ne peuvent accéder à des soins adaptés dans leur territoire. C’est une exigence éthique et une priorité nationale. Avant même de garantir le droit de choisir sa mort, nous devons garantir à chacun le droit de ne pas souffrir.
La discussion parlementaire sera exigeante. Nous aurons des débats sans nul doute nourris, et par moment vifs. Le débat devra permettre d’enrichir le texte, de le consolider, de renforcer ses garanties. Loin des postures ou des anathèmes, ce débat devra être marqué par la rigueur, la mesure et le respect.
Je souhaite insister sur deux points essentiels.
La procédure médicale d’abord. Dans notre système de santé, des décisions graves — sur un traitement contre le cancer, une opération lourde — sont prises collectivement, lors de réunions pluridisciplinaires. Il serait impensable que la décision d’autoriser une aide à mourir ne bénéficie pas de la même rigueur. La collégialité est indispensable pour protéger les patients, mais aussi pour garantir la responsabilité partagée du corps médical. Ce principe doit être solidement inscrit dans la loi.
Les délais, ensuite. Le texte prévoit aujourd’hui une décision rendue sous quinze jours, suivie d’un délai de réflexion de deux jours avant administration du produit létal. Cet équilibre me semble juste. Il respecte le temps du discernement, la nécessité de la concertation, sans ajouter de la souffrance inutile. Certains plaident pour raccourcir ces délais. Je comprends leur intention. Mais nous devons garder en tête que le désir de mourir n’est pas toujours stable. Il peut fluctuer, se troubler, être traversé de doutes. Le temps fait partie de la protection du patient. Et du soin.
Enfin, je veux attirer l’attention sur un enjeu encore trop peu discuté : l’évaluation de la loi.
Il faut regarder en face la manière dont la loi sera appliquée Où seront formulées les demandes ? Sera-t-il plus fréquent d’y recourir dans les territoires où les soins palliatifs sont peu accessibles ? Verra-t-on émerger des inégalités géographiques ou sociales ? Cela serait contraire à l’esprit même de cette loi. C’est pourquoi j’appelle à une évaluation rigoureuse et continue, portant sur la répartition géographique et institutionnelle des demandes acceptées, sur les pratiques médicales, et sur les éventuels liens entre manque d’accès aux soins palliatifs et recours à ce nouveau droit. Nous avons le devoir de ne pas détourner le regard. Et d’ajuster si nécessaire.
Cette loi nous oblige. Elle doit être débattue avec ce que la fin de vie exige : de la dignité, de la mesure et du respect, particulièrement à l’égard de celles et ceux qui la mettront en œuvre — les soignants, les aidants, les familles.
Entendons l’attente des Français. Entendons les professionnels de santé, qui, dans leur grande majorité, soutiennent cette avancée. Elle doit être une loi de liberté, mais aussi de justice et d’équité.
Tel est l’esprit dans lequel j’aborde ce débat parlementaire.
16 mai 2025 | Les élu·es de Place publique